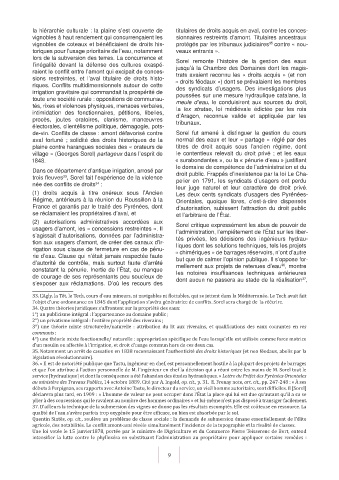Page 9 - lettre_crhssoccitanie_37c
P. 9
la hiérarchie culturale : la plaine s’est couverte de titulaires de droits acquis en aval, contre les conces-
vignobles à haut rendement qui concurrençaient les sionnaires restreints d’amont. Titulaires ancestraux
vignobles de coteaux et bénéficiaient de droits his- protégés par les tribunaux judiciaires contre « nou-
35
toriques pour l’usage prioritaire de l’eau, notamment veaux entrants ».
lors de la subversion des terres. La concurrence et Sorel remonte l’histoire de la gestion des eaux
l’inégalité devant la défense des cultures exaspé- jusqu’à la Chambre des Domaines dont les magis-
raient le conflit entre l’amont qui excipait de conces- trats avaient reconnu les « droits acquis » (et non
sions restreintes, et l’aval titulaire de droits histo- « droits féodaux ») dont se prévalaient les membres
riques. Conflits multidimensionnels autour de cette des syndicats d’usagers. Des investigations plus
irrigation gravitaire qui commandait la prospérité de poussées sur une mesure hydraulique catalane, la
toute une société rurale : oppositions de communau- meule d’eau, le conduisirent aux sources du droit,
tés, rixes et violences physiques, menaces verbales, la lex stratae, loi médiévale édictée par les rois
intimidation des fonctionnaires, pétitions, libelles, d’Aragon, reconnue valide et appliquée par les
procès, joutes oratoires, clanisme, manœuvres tribunaux.
électorales, clientélisme politique, démagogie, pots-
de-vin. Conflits de classe : amont défavorisé contre Sorel fut amené à distinguer la gestion du cours
aval fortuné ; solidité des droits historiques de la normal des eaux et leur « partage » réglé par des
plaine contre harangues sociales des « orateurs de titres de droit acquis sous l’ancien régime, dont
village » (Georges Sorel) partageux dans l’esprit de le contentieux relevait du droit privé ; et les eaux
1848. « surabondantes », ou la « pénurie d’eau » justifiant
le domaine de compétence de l’administration et du
Dans ce département d’antique irrigation, arrosé par droit public. Frappés d’inexistence par la loi Le Cha-
trois fleuves , Sorel fait l’expérience de la violence pelier en 1791, les syndicats d’usagers ont perdu
33
née des conflits de droits : leur juge naturel et leur caractère de droit privé.
34
(1) droits acquis à titre onéreux sous l’Ancien Les deux cents syndicats d’usagers des Pyrénées-
Régime, antérieurs à la réunion du Roussillon à la Orientales, quoique libres, c’est-à-dire dispensés
France et garantis par le traité des Pyrénées, dont d’autorisation, subissent l’attraction du droit public
se réclamaient les propriétaires d’aval, et et l’arbitraire de l’État.
(2) autorisations administratives accordées aux Sorel critique expressément les abus de pouvoir de
usagers d’amont, les « concessions restreintes ». Il l’administration, l’empiétement de l’État sur les liber-
s’agissait d’autorisations, données par l’administra- tés privées, les décisions des ingénieurs hydrau-
tion aux usagers d’amont, de créer des canaux d’ir- liques dont les solutions techniques, tels les projets
rigation sous clause de fermeture en cas de pénu- « chimériques » de barrages réservoirs, n’ont d’autre
rie d’eau. Clause qui n’était jamais respectée faute but que de calmer l’opinion publique. Il s’oppose for-
d’autorité de contrôle, mais surtout faute d’arrêté mellement aux projets de retenues d’eau , montre
36
constatant la pénurie. Inertie de l’État, ou manque les notoires insuffisances techniques antérieures
de courage de ses représentants peu soucieux de dont aucun ne passera au stade de la réalisation ,
37
s’exposer aux réclamations. D’où les recours des
33. L’Agly, la Têt, le Tech, cours d’eau mineurs, ni navigables ni flottables, qui se jettent dans la Méditerranée. Le Tech avait fait
l’objet d’une ordonnance en 1845 dont l’application s’avéra génératrice de conflits. Sorel sera chargé de la réécrire.
34. Quatre théories juridiques s’affrontent sur la propriété des eaux:
1°) un publicisme intégral : l’appartenance au domaine public ;
2°) un privatisme intégral : l’entière propriété des riverains ;
3°) une théorie mixte structurelle/naturelle : attribution du lit aux riverains, et qualifications des eaux courantes en res
communis ;
4°) une théorie mixte fonctionnelle/ naturelle : appropriation spécifique de l’eau lorsqu’elle est utilisée comme force motrice
d’un moulin ou affectée à l’irrigation, et droit d’usage commun hors de ces deux cas.
35. Notamment un arrêt de cassation en 1838 reconnaissant l’authenticité des droits historiques (et non féodaux, abolis par la
législation révolutionnaire).
36. « Il est de notoriété publique que Tastu, ingénieur en chef, est personnellement hostile à la plupart des projets de barrages
et que l’on attribue à l’action personnelle de M. l’ingénieur en chef la décision qui a réuni entre les mains de M. Sorel tout le
service [hydraulique] et dont la conséquence a été l’abandon des études hydrauliques. » Lettre du Préfet des Pyrénées Orientales
au ministère des Travaux Publics, 14 octobre 1889. Cité par A. Ingold, op. cit., p. 31. E. Frenay note, art. cit., pp. 247-248 : « À ses
débuts à Perpignan, ses rapports avec Antoine Tastu, le directeur du service, un vieil homme autoritaire, sont difficiles. Il [Sorel]
déclarera plus tard, en 1909 : « L’homme de valeur ne peut occuper dans l’État la place qui lui est due qu’autant qu’il a su se
plier à des concessions qui le ravalent au nombre des hommes ordinaires » et lui-même n’est pas disposé à transiger facilement.
37. D’ailleurs la technique de la submersion des vignes ne donne pas les résultats escomptés. Elle est coûteuse en ressource. La
qualité de l’eau s’avère parfois trop oxygénée pour être efficace, ou bien est absorbée par le sol.
Quentin Sintès, op. cit., soulève un problème de classe sociale : la demande de submersion émane essentiellement de l’élite
agricole, des notabilités. Le conflit amont-aval révèle simultanément l’incidence de la topographie et la rivalité de classes.
Une loi votée le 15 janvier1878, portée par le ministre de l’Agriculture et du Commerce Pierre Teisserenc de Bort, entend
intensifier la lutte contre le phylloxéra en substituant l’administration au propriétaire pour appliquer certains remèdes :
9